Claire Hédon : « Il faut faire respecter le droit dans tous les domaines, au quotidien »
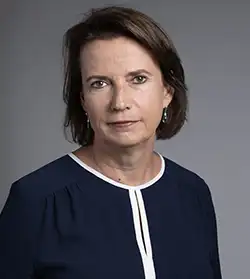 © Miguel Medina/AFPClaire Hédon est Défenseure des droits depuis 2020.
© Miguel Medina/AFPClaire Hédon est Défenseure des droits depuis 2020.
Elle revient sur les grands enseignements du dernier rapport d’activité de l’institution en matière de respect des droits en France et sur les priorités pour sa dernière année de mandat.
Quelles sont les grandes missions du Défenseur des droits ?
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée par la loi organique du 29 mars 2011, suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle a aujourd’hui cinq grandes missions : la défense des droits des usagers des services publics, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, la défense des droits de l'enfant, le contrôle de la déontologie des forces de sécurité, et l'orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
Notre principale mission consiste à traiter les réclamations que nous recevons. Pour 80 % d’entre elles, nous avons recours à la médiation. Nous intervenons en complément de la justice et n’avons pas de pouvoir de contrainte. En revanche, nous pouvons formuler des observations devant les juridictions françaises ou internationales, notamment devant le Conseil constitutionnel et les tribunaux.
Nous menons également des actions de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits. Dans une logique de prévention des atteintes aux droits, nous produisons des rapports et études et rendons des avis au Parlement sur des propositions et projets de loi. L’objectif est de contribuer à réduire l’écart qui existe entre le droit énoncé et son application effective, écart que nous constatons malheureusement au quotidien.
Quels sont les enjeux majeurs aujourd'hui en matière de respect des droits en France ?
Un premier enjeu est de mieux faire connaître l’institution, en particulier auprès des personnes les plus éloignées du droit. Pour y remédier, nous renforçons notre présence sur tout le territoire grâce à l’engagement de nos 630 délégués bénévoles présents dans plus de 1000 lieux d’accueil répartis dans toute la France. Les délégués accueillent, écoutent et orientent les personnes dans leurs démarches et travaillent en lien avec nos juristes. Nous travaillons aussi étroitement avec les associations qui agissent localement, au plus près des populations.
Deuxième enjeu : faire face à la forte hausse des réclamations. En 2020, lorsque j’ai pris mes fonctions, nous recevions près de 100 000 réclamations par an. En 2024, nous en avons reçu 141 000. 90 % de ces réclamations concernent les droits des usagers de services publics. Cela reflète un problème majeur : l’éloignement croissant des services publics, en particulier des personnes les plus vulnérables qui ont plus de difficultés à faire valoir leurs droits (les personnes en situation de précarité, de handicap, les personnes âgées, les étrangers...). Cet éloignement s’explique en partie par la dématérialisation des services publics, devenue dans plusieurs administrations le seul moyen pour réaliser des démarches. Le problème n'est pas la dématérialisation en elle-même, qui présente de nombreux avantages, mais le fait d'en faire le seul accès possible aux services publics. Surtout lorsqu’on sait que 44 % de la population en France rencontre des difficultés pour réaliser des démarches administratives en ligne, selon les chiffres publiés en début d’année par le Crédoc .
Sur le sujet, vous avez notamment publié en décembre dernier un rapport sur l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) qui souligne les effets négatifs de la dématérialisation sur les droits des usagers.
L’exemple de l’ANEF est en effet flagrant : c’est aujourd’hui la seule voie pour obtenir ou renouveler un certain nombre de titres de séjour, et cela prive par conséquent de leurs droits de nombreux usagers qui ne maîtrisent pas la langue et/ou les outils numériques. Cela se traduit d’ailleurs dans l’évolution des réclamations relatives aux droits des étrangers : elles représentaient 10 % de l’ensemble des réclamations en 2019, un quart des réclamations en 2023 et un tiers en 2024. C’est une augmentation considérable. Pour enrayer cette évolution, nous pensons qu’il faut impérativement maintenir des accueils physiques et téléphoniques en complément des démarches dématérialisées.
Vous faites également état dans votre dernier rapport d’activité d'une augmentation des discriminations, en particulier liée à l'origine, avec paradoxalement une baisse des réclamations dans ce domaine. Comment expliquer une telle situation ?
Toutes les enquêtes sur lesquelles nous nous basons montrent une augmentation des discriminations. Par exemple, le service de statistiques du ministère de l'Intérieur, dans l'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS) , relève une « très forte hausse » (+ 52 %) des faits de discrimination entre 2021 et 2022. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne , près de la moitié (47 %) des personnes noires ou de confession musulmane dans l'Union européenne disent avoir été victimes de discriminations dans les cinq dernières années qui précédaient un sondage de 2023. Mais le paradoxe, c'est que l’on constate effectivement une baisse des réclamations que nous recevons dans ce domaine. Cela s’explique par plusieurs raisons, que nous précisons dans un baromètre réalisé en 2024 avec l’Organisation internationale du travail sur la perception des discriminations dans l’emploi en France : la peur des représailles, l’impression qu’un signalement ne changerait rien ou encore le fait de ne pas avoir de preuves.
C’est pourquoi nous demandons la création d’un observatoire spécial au sein du Défenseur des droits pour pouvoir évaluer de très près l’évolution des discriminations, en rassemblant les études existantes sur le sujet et en en réalisant d’autres en complément.
Vous avez dit au CESE en 2024 : « C'est en respectant les droits que l'on fait démocratie et que l'on crée de la cohésion sociale ». Quels risques la fragilisation de l’Etat de droit fait-elle courir à la démocratie ?
J'aime beaucoup notre devise républicaine qui fonde notre démocratie, « Liberté, Egalité, Fraternité », mais il y a urgence à la rendre plus concrète. Il faut faire respecter le droit dans tous les domaines, au quotidien. C’est le cœur de la mission de notre institution. Pour cela, il faut déployer plus de moyens pour réparer les écarts qui existent entre la loi et son effectivité.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est essentiel de renforcer la protection des lanceurs d’alerte, indispensables au maintien de l’Etat de droit et de la démocratie. Nous avons publié en septembre 2024 notre premier rapport bisannuel sur le sujet . Les lanceurs d’alerte sont toutes les personnes qui se trouvent confrontées à des faits répréhensibles ou contraires à l’intérêt général, et qui engagent des démarches de signalement. Ils peuvent être aussi bien des agents de crèche, des soignants, des professeurs, des salariés d’entreprises… La protection des lanceurs d’alerte a été améliorée par la loi de 2022 mais il reste encore des lacunes. Il faut notamment renforcer l’information sur leurs droits et leur prise en charge psychologique. Il faut également élargir le champ de la protection aux personnes morales, comme les entreprises, puisque la loi ne concerne aujourd’hui que les personnes physiques.
Quelles sont vos priorités pour les prochains mois ?
Nous avons relancé notre grande enquête sur l'accès aux droits de 2017, afin d’établir un état des lieux des atteintes aux droits relevant des domaines de compétence de notre institution. Nous avons publié au mois de juin le premier volet de cette grande enquête relatif à la déontologie des forces de sécurité. Les prochains volets porteront sur les services publics, les discriminations dans l’emploi, les publics vulnérables et les droits de l’enfant.
Sur ce dernier point, nous travaillons en particulier sur les conséquences des crises écologiques sur le droit des enfants à vivre dans un environnement sain. Parmi les situations critiques : les zones rurales par exemple, lorsque certaines écoles se trouvent à proximité de champs dans lesquels sont utilisés des pesticides. Ou encore les zones d’habitation à proximité des autoroutes où des familles sont exposées à une très forte pollution atmosphérique. Ce sont des sujets primordiaux pour la protection de l’enfance.
Nous travaillons également sur la question de l’intelligence artificielle. Les nouvelles technologies d’IA peuvent êtres très utiles, notamment pour les services publics, mais il y a plusieurs points de vigilance. Au-delà des biais discriminatoires qui peuvent exister, il est primordial que les usagers soient informés lorsqu’il n’y a pas d’intervention humaine dans les services dématérialisés qu’ils utilisent. Nous préconisons que cette exigence de transparence soit inscrite dans la loi.
Quel peut être selon vous le rôle de la philanthropie en matière de défense des droits et libertés et de lutte contre les discriminations ?
Le secteur philanthropique joue un rôle essentiel dans le soutien aux associations, dont les actions sont fondamentales en matière de défense des droits. Comme je l’évoquais précédemment, le Défenseur des droits travaille en lien étroit avec la sphère associative pour mener à bien ses missions. Nous sommes en lien avec plus de 110 associations qui agissent sur tout le territoire et identifient les besoins dans de nombreux domaines relatifs au respect des droits. Ils nous font part des difficultés qu’ils constatent et orientent les personnes concernées vers notre institution. Je vais régulièrement rencontrer nos partenaires associatifs pour échanger avec eux sur les difficultés concrètes d'accès aux droits par exemple.
Dans un contexte où les associations sont fragilisées par la baisse des subventions publiques, il est indispensable que des acteurs privés comme les fondations les soutiennent afin qu’elles continuent à jouer leur rôle clé pour la société et des institutions comme la nôtre.
Je veux recevoir la Lettre de la philanthropie :

